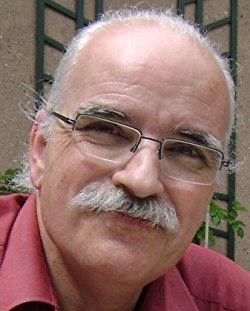
Jour 9. Fenêtre sur cour de Diego Arrabal, le tarbais auteur de polars dont « Jour de colère» et « N’y voyez rien de personnel». La prochaine enquête du commissaire Ney « le principe des trois signes » sortira en septembre 2020 aux Éditions Arcane 17.
_____________________________________________
Fenêtre sur cour
La nuit tombe sur Tarbes. La nuit tombe sur ce dixième jour de confinement. Dix jours à tourner en rond dans mon petit appartement, de la chambre au séjour, du séjour à la minuscule cuisine, et retour à la chambre. 30 mètres carrés au second étage d’un immeuble des années 50 à l’insonorisation imparfaite. Tonnerre grondant lorsque Marcel mon voisin du dessus tire sa chasse d’eau, ou halètements suggestifs lorsque Juliette la voisine de droite calme son stress entre les bras de son jules. Mais je ne peux pas me plaindre, l’immeuble est malgré tout très calme car non seulement il est quasiment vide, mais n’y demeurent pratiquement que des séniors, comme on dit aujourd’hui pudiquement. Silencieux, ils contemplent la pendule qui égrène les secondes qui fuient. Esseulés habituellement, la pandémie qui sévit les a définitivement coupés de tout contact avec le monde des vivants. Juliette est notre benjamine, et moi-même malgré mes soixante-dix ans suis encore le plus jeune après elle. Oh, mon immeuble n’est pas exceptionnel, Tarbes est une ville qui a perdu sa jeunesse avec ses industries, elle ne périclite plus d’ailleurs, elle agonise.
La nuit est tombée et une seule fenêtre s’est allumée dans la cour de l’immeuble. Oui, mon appartement ne donne que sur la cour, alors je n’ai comme loisir, - si je veux oublier la télévision qui nous distille formules martiales creuses et séquences alarmistes – que de contempler la monotonie que partagent mes quelques voisins. Lui, je ne l’avais jamais croisé. Je ne voyais que sa femme, vacant à des occupations ménagères. Parfois je la croisais chez le boulanger, elle me jetait un regard fuyant en remontant le col de sa veste trop chaude pour la saison, puis s’éloignait rapidement comme une petite souris, tête basse. Là, depuis que le monde s’est refermé pour nous tous sur nos intérieurs, c’est lui que je vois chaque fois que je m’approche des carreaux. Il traîne tristement sur le canapé, vidant consciencieusement une bouteille de vin ordinaire, tandis qu’elle trotte industrieusement de ci, de là dans l’appartement. J’ignore son nom, j’ignore leur nom.
Depuis un ou deux soirs ils ne baissent même plus leurs volets, happés par la lassitude de ces journées qui s’étirent sans repères. Le jour vaut la nuit. L’instant s’étire à l’infini, les jours se suivent identiques comme dans ce film : Un jour sans fin. Alors à quoi bon refaire les mêmes gestes ? Le temps se fige. Je suis là, spectateur d’une scène banale sans passé, sans avenir. L’image fugace du tableau Nighthawks de Hopper, immobilisant des protagonistes las traverse mon esprit. Et là, par une de ces associations d’idées dont le fil nous échappe, je repense à cette générale d’En attendant Godot dans les locaux désaffectés des subsistances militaires de Strasbourg. Ces travées dominant le plateau où était reconstitué le café de Nighthawks. Ces comédiens débitant le texte superbe d’économie de Beckett, d’autres ici ou là sur le faux trottoir d’en face qui s’embrassent en amoureux ou se disputent. Seules nous parviennent les voix des personnages. Je ressens encore cette sensation ambiguë de ne plus être spectateur mais voyeur. Projeté dans cet instant découpé arbitrairement, privé d’avant et conscient qu’il n’y aura pas d’après. Un pur voyeur qui assiste par effraction à cette étroite tranche de vie.
Ma pensée se brouille soudain, ai-je bien vu ? La scène est-elle une projection de mon imagination ou la réalité de ce qui vient de se passer chez mes voisins ? J’hésite car mon introspection m’a distrait et j’ai peut-être perdu de vue la fenêtre, reconstituant dans ma solitude un acte qui me dépasse. Il n’y a plus que lui, debout. Enfin plutôt, il s’est levé est maintenant il est penché. Elle a disparu. J’imagine qu’elle est au sol. Peut-être est-elle simplement tombée et ma solitude a-t-elle brodé inventant ce geste fatal ? Mais non je le vois bien continuer ses grands moulinets, comme autant de coups de poings rageurs. Un dernier coup. Il s’abaisse comme pour vérifier si elle est morte ou vivante. Je suis tétanisé par ce déferlement de violence. Je le vois qui se relève lentement, il se passe les mains sur le visage, celui-ci se zèbre de traînées sombres. Il tourne la tête soudain, conscient que ses volets ne sont pas tirés. Je réalise que ma silhouette se détache clairement car mon plafonnier est allumé. Je me retire mais ses yeux se vrillent sur moi. Je recule lentement pour tenter d’éteindre. Mais il est trop tard.
Que faire ? Téléphoner à la police ? Mais me croiront-ils ? D’ailleurs suis-je vraiment sûr d’avoir vu cette agression ? Ne serait-elle pas tombée accidentellement ? Je tourne en rond. Je vais dans la chambre pour décrocher le téléphone. Je commence à composer le 15, mes mains tremblent. Je dois m’y reprendre à deux fois. Enfin la sonnerie. Elle s’éternise. Ma conviction fluctue. Je raccroche. Je retourne au séjour. Un timide coup d’œil vers la fenêtre de mon voisin. Il y a toujours de la lumière, mais plus personne n’est visible dans la pièce. J’imagine qu’il téléphone peut-être aux secours. J’attends, au cas où il reviendrait dans mon champ de vision. Les minutes s’écoulent tandis que lentement mon cœur se calme. La sonnette tinte, je décroche l’interphone. Une voix ferme annonce la police et me demande d’ouvrir. J’essaye de savoir pourquoi, mais la voix m’informe seulement d’un appel impérieux reçu. J’obtempère.
J’ouvre avec précaution ma porte, oscillant entre la curiosité morbide et la crainte intuitive. L’escalier est éclairé, j’entends l’ascenseur en action, puis la porte s’ouvre à l’inter-étage supérieur. Je souffle. Marcel a dû lui aussi voir l’agression et malgré ses 90 ans il a réagi prestement. J’ai honte d’avoir tergiversé. Et suis rassuré de la rapidité d’intervention des policiers. Je m’avance un peu pour capter la conversation à l’étage au-dessus, mais étrangement tout est silencieux. Un mouvement sur la dernière marche attire mon regard. Le temps que je réalise, le voisin de la cour est sur moi, me bouscule dans l’appartement, l’œil injecté de sang. Je baisse le regard et la dernière chose que je vois est un long couteau de cuisine qui s’élance vers ma poitrine.
Diego Arrabal, 27 mars 2020



